Le site (Antoine) /
- Vous n’avez pas rêvé : le compte-rendu du Hellfest 2025 fut mis en ligne vendredi dernier, soit à peine deux semaines avant la prochaine édition. Il ne s’agit certes que de la première partie, mais avouez que l’effort est spectaculaire. Le suspense reste entier sur la parution de la seconde avant le 18 juin, soit l’ouverture de l’édition 2025.
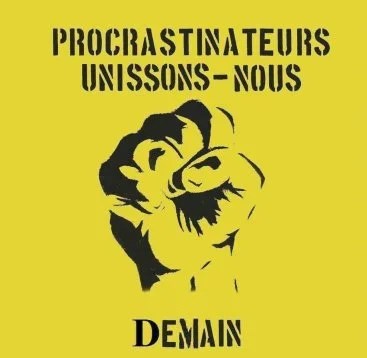
Il est temps de rallumer la littérature (Antoine) /
- Peut-on évoquer un bouquin traitant d’une série télévisée dans une rubrique consacrée à la littérature ? La réponse est oui, d’une part parce que la décision m’appartient, et d’autre part puisque l’écriture du livre elle-même relève d’une forme d’exploit littéraire. L’amour que porte l’auteur de ces lignes à Seinfeld n’est plus tout à fait étranger aux lecteurs réguliers de 130livres.com depuis la publication l’an passé d’un long papier sur la série intitulé Seinfeld ou 180 nuances de rien. Son titre faisait référence au « show about nothing », à la fois running gag de la saison 4 et surnom couramment attribué à la sitcom aux 4 milliards de dollars rapportés rien qu’en rediffusions. Légèrement antérieure à Friends, avec laquelle elle partagea l’antenne de NBC de 1994 à 1998, la série de Jerry Seinfeld et Larry David dépeignait les habitants de New York tels qu’ils étaient perçus par leurs compatriotes plutôt que comme de sympathiques adulescents à la conquête de la ville des possibles : Jerry, George, Elaine et Kramer y formaient un quatuor de névrosés fondamentalement égoïstes évoluant dans un vaste asile à ciel ouvert. « No hugging, no learning » : ni réconfort mutuel, ni espoir d’apprendre de ses erreurs. Le mantra de Larry David visait à filtrer de Seinfeld la moindre trace de feel good.
- Le pacte conclu avec le téléspectateur était alors le suivant : « oui, le propos est irrémédiablement pessimiste, mais vous allez rire, beaucoup, à la fois d’eux et avec eux. » Impossible en effet de dissocier l’humour tour à tour caustique, burlesque et absurde des situations quotidiennes que les scénaristes observaient avec une douloureuse acuité. La vie des personnages de Seinfeld n’en était justement pas une, ce qui importait peu tant qu’on se gondolait – et Dieu sait si c’était le cas. Or Hendy Bicaise, dans un essai intitulé très à propos Seinfeld, fini de rire à paraître le 12 juin prochain chez Playlist Society, relève ce défi insensé : pour sonder les profondeurs existentielles que hantent ses personnages, parler de la série sans jamais en rigoler. Cette posture contre-nature est tenue du début à la fin des 160 pages, et pour qui est familier de Seinfeld il s’agit d’un exploit. L’effet produit est d’autant plus brutal ; comme le dit élégamment la quatrième de couverture, on mesure enfin combien le génie de la série résidait bien dans « l’art de faire rire pour ne pas pleurer ». Où l’on est en droit d’évoquer la série la plus ashkénaze de l’Histoire.
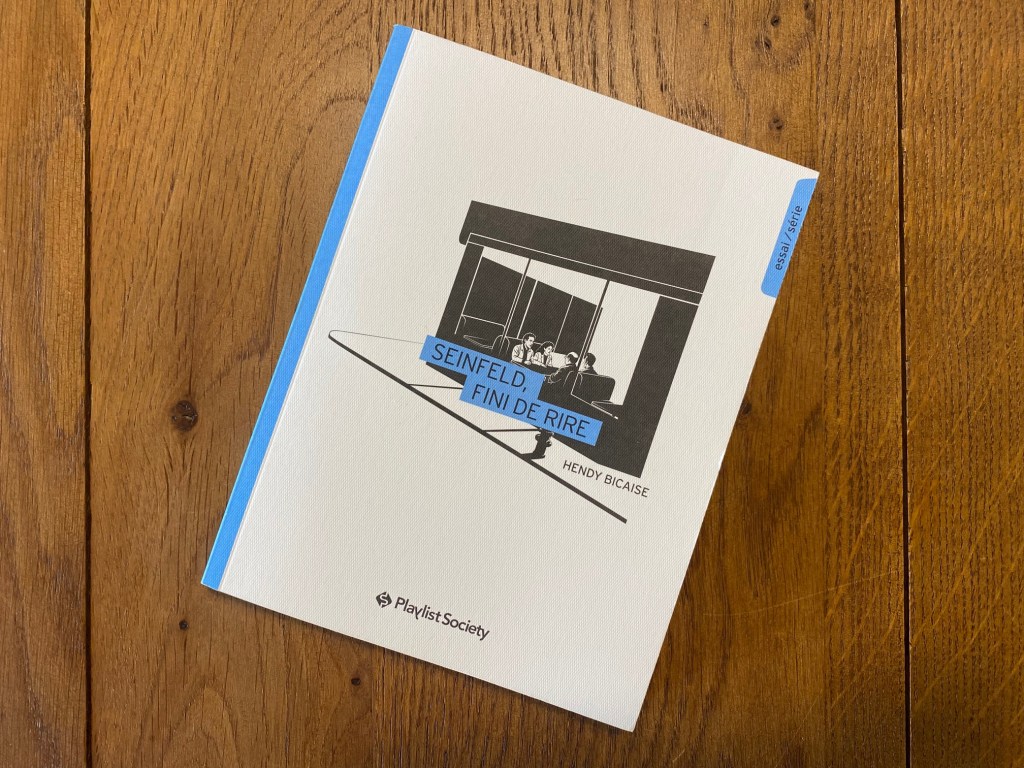
- De manière clinique, l’auteur décortique scènes et arcs narratifs pour en révéler des ressorts toujours sombres, multipliant les notes de bas de page et invoquant philosophes anciens et modernes, de Cicéron à Jankélévitch en passant par Hegel. Après avoir analysé les failles particulières de chacun des protagonistes, Bicaise pointe la dynamique jamais vertueuse de leurs relations amicales. Puis il révèle comment la mise en abîme permise par l’utilisation régulière de la figure du double met « les quatre névrotiques » face à leurs démons. Plus glaçant encore, il expose la claustration dans l’espace et le temps dont tous font les frais, pour finalement se retrouver confrontés au vide et à leur propre finitude. Bien sûr, on rit aussi peu que lui, quand bien même le livre donne l’occasion de revivre des dizaines de gags tordants – parfois à l’extrême. Littéralement renversante, une telle expérience de lecture est d’autant moins anodine qu’elle nous renvoie à nos propres similitudes avec les personnages, donc à du guère joyeux, et cependant elle ravive de fait le sentiment d’une urgence absolue, celle de savoir en rigoler. Ajoutons pour conclure une mention à la parfaite couverture de Lucien de Baixo, transposition des innombrables repas chez Monk’s dans un univers finalement si proche bien que moins riche de rires enregistrés, celui des Nighthawks d’Edward Hooper baignés de solitude et de mort. De quoi comprendre pourquoi la lecture de Seinfeld, fini de rire est rigoureusement indispensable à tout mordu de la série. Enfin, presque qu’autant qu’un visionnage de plus.
Le cinéma est mort, la preuve : il bouge encore (Guillaume) /
- Parlons cinéma, parlons plateforme. Bah oui, cette semaine, c’est le cinéma à la maison pour 15 euros par mois sans les pubs qui a retenu l’attention de votre serviteur. D’autant qu’une fois n’est pas coutume, le long-métrage concerné présente des velléités de grand écran trop souvent absentes des films qui les squattent sans égards pour leur glorieux support. De la télévision au cinéma, ou du cinéma à la télévision, bref : dans un monde mal ordonné, le plus simple reste encore de choisir tout simplement un bon film. Ce que vous trouverez assurément (et plus encore) dans M. Wolff 2 : un bon film, un vrai. Animé de cette exigence du travail bien fait qu’on trouvait chez les professionnels du Hollywood vintage, un souci de ne pas faire comme tout le monde sans tomber dans la posture, et… De l’humain. Beaucoup d’humain.
- Ça parait bête dit comme ça, mais c’est déjà ce qui faisait toute la différence dans le premier volet, succès surprise de 2014 qui tenait son high concept à tiroirs (un comptable autiste, blanchisseur d’argent pour les cartels, qui se révèle une sorte de vigilante à l’échelle internationale) avec le sens de la ligne claire narrative des grands cinéastes classiques américains. Celle que maitrise sur le bout des doigts Gavin O’Connor, artisan faussement scolaire doté d’une remarquable capacité à transcender des cahiers des charges parfois lénifiants comme s’il venait de les inventer. L’homme n’est ni un génie de la caméra à proprement parler, ni un iconoclaste. Par contre, il sait raconter comment toujours raconter la même histoire au spectateur- en général, deux frères qui ont besoin de se mettre sur la gueule pour (enfin) se parler – sans jamais le prévenir.

- O’Connor a l’élégance de ne jamais le dire dans le texte, il l’écrit en petits caractères à l’image. Comme une mélodie sous-jacente qui s’imprime dans l’impensé du spectateur avant de jaillir de l’écran comme une lame de fond. Il y a quelque chose qui relève presque de la psychanalyse chez O’Connor, et son cinéma d’hommes qui sonde le cœur de ses personnages avec les moyens de son médium pour déterrer l’évidence qui se dit en quelques mots, et souvent à la fin. Comme c’était le cas de M. Wolff donc, et son twist concrétisant ce qui avait été conscientisé en amont. Un cinéaste avec du cœur, sur un scénario malin : il n’en fallait pas plus pour faire du film un de ces petits classiques du dimanche soir qui se boit sans soif.
- C’était d’ailleurs le principal défi de cette suite sans doute trop tardive pour capitaliser sur le succès du premier : réussir à maintenir l’intérêt du spectateur après que le secret ait été éventé. Autrement dit, dépasser le high-concept pour élargir l’univers en nous accrochant avec ce qui a fonctionné auparavant. À savoir SPOILER SI VOUS N’AVEZ PAS VU LE PREMIER- la relation entre les deux frères, joués par Ben Affleck, super-comptable et encore plus super-héros autiste de son état, et Jon Bernthal, son frère tueur à gages grande gueule moins doué mais bien résolu à ne pas jouer les sidekicks. M. Wolff 2 prend donc la couleur d’un buddy movie– façon Rain Man sous stéroïdes comme le dit O’Connor- qui transforme son argument de genre en road-movie initiatique, agrémenté de quelques fusillades sur le chemin.
- Affleck et Bernthal font la guerre à un réseau de trafic d’êtres humains pour se retrouver, se renifler, se chambrer, et au final se réconcilier entre chien et chat. Le duo fonctionne du tonnerre- Affleck, plus lui-même que Dustin Hoffman, Bernthal, lui-même en extra-large- et s’en donne à cœur joie autant qu’à cœur ouvert dans des scènes de ménages fraternels qui en disent tellement en peu de mots évocateurs. Qu’on se le dise, écrire des dialogues pour le cinéma est un art qui ne se mesure pas qu’à la qualité de la punchline. Chapeaux bas à Bill Dubuque le scénariste, et sa propension à étendre sa cosmogonie en faisant une place à TOUS les personnages sans perdre de vue son cœur de réacteur.
- Au fond, ce M. Wolff 2 réussit là ce que Marvel n’est jamais réellement parvenu à accomplir : réaliser une vraie « comédie humaine » sans transformer son univers élargi en sitcom. Il y a bien des quelques tâches sur le costume amidonné, notamment un manque de créativité dans des scènes d’actions qui souffrent de la comparaison avec le premier opus. Rien qui n’entame l’envie d’y retourner quasi immédiate après la fin du générique. Ni le regret que cette belle proposition de cinéma authentiquement populaire se retrouve enchainée à l’anodin du tout-venant des catalogues de plate-forme. Bloody shame.
Ce qui reste de la boxe anglaise (Antoine) /
- La frappe, la patate, la foudre, la praline, le marteau de Thor, la colère de Dieu, le baiser de la mort ou tout simplement le punch : telle est la merveille que les lois de la biomécanique n’expliquent pas tout à fait et qui fascine depuis toujours les amoureux de la boxe anglaise. Je n’ai pas dit « du noble art », parce que justement le punch échappe souvent à la technique, et que la maîtrise absolue du geste ne garantit aucunement son efficacité – un peu comme le plus orthodoxe des golfeurs, à gabarit équivalent, ne tape pas toujours le plus long drive. Inversement, d’aucuns éteignent les consciences d’un coup sans même avoir besoin que leur coup porte nettement dans une zone réputée fatale ; Deontay Wilder a fondé toute une carrière sur ce super pouvoir. Si l’Américain n’a pas encore raccroché les gants, il a déjà des héritiers chez les poids lourds. Ainsi, Fabio Wardley. Déjà fameux pour avoir fichu en l’air ses compatriotes invaincus David Adeleye et Frazer Clarke, l’Anglais s’est sorti d’un bien mauvais pas, samedi soir devant un stade d’Ipswich tout entier acquis à sa cause, en trouvant d’une droite parfaite la pommette gauche d’un Justis Huni pour une fois imprudent au moment de déclencher.
- 9 rounds durant, l’Australien mobilisé à cinq semaines de l’échéance avait surclassé le favori boxant à domicile en imposant sa pression, son rythme et ses feintes, rentrant toujours dans le bon timing tout en veillant à ramener vite sa main avant et la garder bien haute. Il aura donc suffi d’un défaut dans la cuirasse pour que la droite de Wardley, battu comme plâtre et mis sur le reculoir pendant presque une demi-heure sans la moindre ébauche de plan B, actionne le bouton « off ». Certains auront trouvé l’arbitre prompt à arrêter un Huni de nouveau sur pieds au compte de 8, voire cruel d’avoir interrompu une telle prestation ; je crois pour ma part qu’à ce moment précis il aurait sans problème pu croire être en train de jouer à la marelle dans un cratère de la Lune. Bref, le punch hors normes de Wardley – désormais 18 KOs sur 19 succès en carrière – lui aura permis de rattraper une situation compromise à l’extrême. On lui recommandera de travailler au tableau noir des solutions moins aléatoires à l’heure d’aborder le gratin de la catégorie, mais d’ici-là accordons-lui que le dernier boxeur debout est toujours celui qui a raison. Quant à Huni, souhaitons-lui d’avoir pu se rappeler son adresse postale et le code de la porte d’entrée. Ce qu’il a montré contre Wardley mérite une revanche… à supposer que Frank Warren accepte la prise de risque.

- On peut boucler une exceptionnelle carrière de boxeur qui laisse pourtant un goût d’inachevé : voilà qui résume mon sentiment à l’annonce de la retraite de Vasyl Lomachenko à l’âge de 37 ans. « Matrix » Lomachenko, c’est une défaite en 397 combats amateurs, deux médailles d’or olympiques et autant en championnats du monde, puis une première ceinture majeure chez les pros dès sa troisième sortie en plume suivie de titres à 130 et 135 livres en l’espace d’à peine 12 combats. Si l’Ukrainien, intégré un temps à un bataillon de défense territoriale près d’Odessa en 2022, n’a jamais été champion incontesté d’une catégorie, il fut largement considéré comme le meilleur du monde dans chacune de celles qu’il fréquenta, et beaucoup lui ont attribué le titre linéal des légers après la victoire de 2019 sur Luke Campbell qui lui permit d’unifier trois des titres mondiaux. Entraîné par son père Anatoly « Papachenko », le poids plume naturel Vasyl Lomachenko présente aussi la particularité d’avoir bien souvent affronté plus grand et costaud que lui, parfois d’authentiques welters. Il compensait son déficit de taille et d’allonge par une technique et une vitesse rarement vues sur un ring. Les pivots du gaucher « Loma » relevaient de la pure poésie pugilistique, et sa spéciale, le décalage sur la droite suivi d’un jab pour repiquer à gauche sur un enchaînement de près à la tête et au corps, a rendu chèvres quantité d’adversaires. Quatre fois de rang, des vétérans solides abandonnèrent dans leur coin en championnat du monde. Comment diable y trouver un goût d’inachevé ?
- Et bien… trois raisons expliquent selon moi pourquoi le futur pensionnaire du Hall of Fame ne sera pas dans la discussion des « all-time greats », en tout cas pas dans la mienne : l’adversité, le sens tactique et les combats mémorables. Côté adversité, le tableau de chasse de Matrix en professionnels manque un peu de lustre à l’heure de désigner l’un des plus grands, si l’on considère justement que la définition du « all-time great » est d’avoir vaincu d’autres pensionnaires du Hall of Fame. Reprenons la liste de ses victimes les plus éminentes : qui de Gary Allen Russell, Nicholas Walters, José Pedraza, Anthony Crolla, Luke Campbell, Richard Commey ou George Kambosos, bien qu’adversaires de valeur, pourra vraiment prétendre à une élection au club très exclusif des boxeurs ayant marqué leur époque ? Jorge Linares, également champion du monde dans 3 catégories, aura de son côté un dossier défendable à défaut d’être en béton armé. Le cas de Guillermo Rigondeaux est similaire : si le Cubain fut un titan en amateurs, on peut interroger ses performances chez les pros, a fortiori à 130 livres pour le duel livré à Loma – il boxait plutôt à 118 ou 122. Tout dépendra de la concurrence les années où Linares et Rigondeaux seront éligibles au Hall of Fame, ni l’un ni l’autre n’étant assurés du sésame.

- Regardons maintenant l’historique des défaites de Lomachenko et ce qu’elles nous apprennent du champion. Dans le cas d’Orlando Salido en 2014, le constat est clair : prototype du bagarreur mexicain jamais croisé en amateurs, cet adversaire-là venait trop tôt pour un combat en 12 rounds, le deuxième de « Loma » chez les pros – et se présenta de surcroît trop lourd à la pesée. Ce soir-là, on vit un Ukrainien désemparé par le pressing et les coups illicites de Salido, et incapable d’y répondre autrement qu’en interpellant l’arbitre. Le contexte très particulier de ce premier revers appelle à la clémence, le blâme étant plutôt à imputer aux responsables du matchmaking. Reste la suite, et des défaites contre Teofimo Lopez et Devin Haney. Dans l’un et l’autre cas, Loma concéda de courtes décisions à des hommes naturellement plus imposants. Rien de déshonorant sur le papier, d’autant plus que les pointages sont discutables, en particulier face à Haney. Reste que Lomachenko lui-même peut se reprocher des choix tactiques inopportuns, démarrant trop tard contre Lopez et longtemps figé dans une « spéciale » attendue et neutralisée par Haney. Si talentueux qu’il fût, l’Ukrainien me laissa l’impression d’un virtuose supportant mal la contrariété et guère porté sur les ajustements.
- En plus d’un tableau de chasse restreint parmi l’élite, voilà qui constitue une seconde limite. La derrière barrière d’entrée au Valhalla qui s’y ajoute est le manque – relatif – de souvenirs marquants. On se rappellera de Lomachenko ses démonstrations face à des adversaires à sa main ou des défaites tactiques frustrantes, mais finalement guère de grands combats, ceux qui cimentent un héritage unique dans l’esprit des fans d’une génération et des suivantes. Aurait-ce pu être un duel contre Gervonta Davis, que le management de ce dernier laissa mariner de longues années durant ? Si Loma ne saurait être tenu responsable des manœuvres d’évitement dont il fut l’objet, il demeurera hélas difficile d’associer son nom à un ou plusieurs moments d’anthologie. Voilà pourquoi je peine en tant que fan – ayant regardé tous ses combats télévisés en espérant qu’il les remporte, à la notable exception de sa finale olympique contre Khedafi Djelkhir – à considérer la très grande carrière de Vasyl Lomachenko comme une promesse tenue jusqu’au bout. Ce n’est pas le premier des paradoxes dans mon parcours d’aficionado, et il ne m’empêche pas de tirer mon chapeau à un bien beau champion de son époque. Merci à lui.
Le MMA va bien, merci pour lui (Guillaume) /
- Parlons de MMA, parlons de l’UFC 316, et d’un champion destiné à le rester longtemps. Merab Dvalishvili, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne fait pas pourtant pas partie des « préférés » de Dana White. Pas assez bankable, trop lutteur et trop d’Europe de l’Est pour s’imposer comme une tête de gondole toute désignée. On se doute sans craindre de se tromper que White avait croisé tous ses doigts pour voir Sean O’Malley récupérer la couronne ce soir-là, après l’avoir perdu contre Dvalishvili dans un premier combat à quasi sens unique. La machine de com contre la « The Machine » tout court. Dvalishvili, c’est un cardio à épuiser un Uruk-Hai, une pression constante et sans baisse de tension contre son adversaire, une lutte qui ne s’arrête pas avant d’avoir obtenu le takedown bref : un problème en caractère gras. Le pieds-poings de sniper d’O’Malley, aussi élégant et agréable à l’oeil soit-il, n’avait pas pu grand-chose lors de leur premier affrontement. Même le meilleur gameplan du monde ne peut rien contre un train à vapeur sans arrêt aucuns jusqu’à sa destination, surtout quand il gobe les coups comme des Skittles. O’Malley disait avoir trouvé la réponse : changement de vie, changement d’entrainement, changement de tout. Il était prêt.
- Sauf que non.

- Dès le premier round, on sent que ça va coincer. O’Malley touche, résiste aux takedowns, mais ne réussit jamais à trouver sa distance, et le Géorgien ne parait guère inquiété par les frappes de son adversaire, moins précis qu’à l’accoutumée. En dépit d’une seconde reprise plus équilibrée en faveur d’O’Malley, on sent que l’arbre ne va pas tarder à tomber. D’autant que Dvalishvili profite de l’appréhension adverse de sa lutte pour toucher en anglaise, annulant la suprématie de l’Américain sur son domaine de prédilection. Le troisième round sonne le glas. Dvalishvili se lâche, emmène « Sugar » contre la cage. Une tentative de takedowns, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu’à ce que ça passe. Relentless, au sens propre.
- Le cardio travaillé pour l’occasion d’O’Malley se fait la malle, et lorsque la machine lui passe un étranglement nord-sud, il n’a plus les réserves métaboliques pour résister, et tape. O’Malley le reconnait dans l’interview post-combat : il a fait tout ce qu’il a pu, mais Dvalishvili est un « motherfucker ». À l’heure actuelle, seuls des combats par défaut se profilent pour le Géorgien, qui a déjà nettoyé la division et exclut toute montée en poids pour le moment. Clairement le champion le plus dominant du moment dans l’organisation reine. À noter qu’à la fin du pugilat, le gagnant et le perdant sortent l’un après l’autre de la cage pour faire une révérence à Donald Trump, présent comme à l’accoutumée aux côtés de Dana White. Obligation non-contractuelle imposée par le CEO, supporter et ami affiché de l’Agent Orange, ou admiration sincère ? On ne sait pas, et on vous laisse juge. Mais le spectacle laisse quand même un drôle d’arrière-goût.