Le site (Antoine) /
- Un rythme de publication erratique, certes, mais régulier à sa manière. Enfin je me comprends.
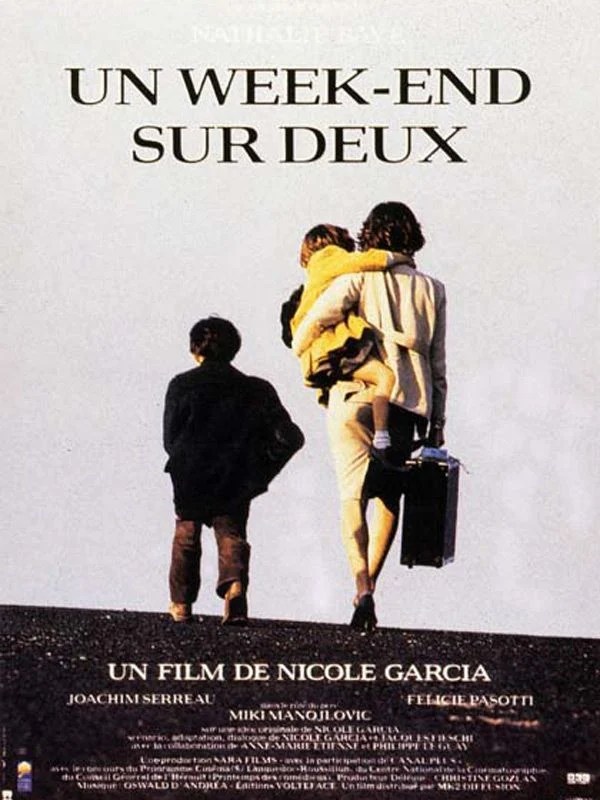
Il est temps de rallumer la littérature (Antoine) /
- Ceux d’entre vous qui consultent mes piges pour Lire savent que je n’ai rien d’un votant de la regrettée École des fans à l’heure d’attribuer la note de une à cinq étoiles résumant – un peu abruptement – chaque avis sur un nouveau bouquin. Depuis 2020, voire 2019 si l’on compte un passage au Magazine Littéraire d’avant la fusion avec Lire, je n’ai attribué les cinq étoiles qu’à deux reprises, dont une fois l’an dernier à l’étrange Bibliothèque du beau et du mal de la Lithuanienne Undinė Radzevičiūtė, paru chez Viviane Hamy. Le second livre dont il est question est sorti voici un mois dans la collection Sygne de Gallimard : L’Époux, du médecin et poète installé aux États-Unis Patrick Autréaux. Sans entrer dans les détails de l’oeuvre – lisez Lire ! -, sachez qu’il y est question du parcours philosophique de l’auteur, en particulier depuis sa rencontre et son mariage avec celui, jamais nommé, qui partage sa vie. En s’unissant à lui, l’auteur a embrassé sa culture juive, nourrissant ainsi sa quête métaphysique de toujours d’une abondante littérature et de quantité de voyages en Terre Sainte. On ne croise pas souvent de récits aussi exigeants écrits d’une langue à ce point singulière sans jamais forcer ses effets, ni d’histoires d’amour décrivant avec autant de justesse la manière dont côtoyer l’autre fait grandir au plan spirituel. L’Époux a ravivé mes questionnements sur l’opportunité d’attribuer les fameuses cinq étoiles. S’agit-il d’un livre parfait, comme semble l’indiquer la note ? Probablement pas, et je suppose que les considérations théologiques d’un auteur attaché à s’affranchir de la question du sacré décramponneront plus d’un lecteur. Et cependant, en comparant le livre aux sorties que je chronique mois après mois depuis bientôt sept ans, je ne peux m’empêcher de lui reconnaître une grâce particulière. Bref : peu importe la quantité d’étoiles, l’important est qu’il soit lu.

- Publié le 27 mars, Intérieur nuit, l’essai dans lequel l’animateur du 7-10 de France Inter – et lecteur fervent, à en croire ses 80 secondes de chroniques quotidiennes – Nicolas Demorand évoque sa bipolarité, se hisse d’entrée au 8e rang des ventes de livre en France. J’aimerais trouver une blague à faire là-dessus, mais l’idée qu’on fasse mieux connaître ce genre de sujet me plaît assez.
- Semaine après semaine, la maison Fayard creuse avec zèle son nouveau sillon éditorial : mercredi prochain sortira ainsi Pour qui roule Médiapart ?, une enquête au titre explicite signée Christian Gaetner. Bon, euh, hum, on dira que le propos – apparemment à charge – m’agace moins que d’habitude.
- Au-delà des habituelles dédicaces d’auteurs et des fiches bristol attendues qui, attachées aux couvertures avec le trombone de rigueur, donnent l’avis des employés, il n’est pas complètement évident d’enrichir l’offre d’une librairie, à plus forte raison en se montrant innovant. saluons donc la création d’une librairie napolitaine baptisée Luce – la lumière – relatée par le site ActuaLitté. Né d’une idée de l’écrivain Lorenzo Marone et de la médiatrice familiale Roberta Nicodemo, l’établissement présente ses ouvrages non plus classés par pays ou thématiques, mais par état d’âme : c’est l’avènement d’une littérature envisagée comme thérapie, selon que le client aspire à « amplifier la joie, adoucir la tristesse, apaiser l’anxiété, calmer la colère… » Un rayon « dépression » aiderait probablement à supporter l’actualité hexagonale.
- À ce titre, on évoquera par exemple la fermeture sèche de la librairie Gibert Joseph de Vaulx-en-Velin prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon jeudi dernier. Le commerce peinait notamment à s’acquitter des 650000 euros de loyer annuel pour son local de 2200 mètres carrés. Vivement l’ouverture d’un Basic Fit.
- Et puis à propos de Lyon, la 21e édition du festival Quai du polar, institution de la capitale des Gaules, avait lieu ce week-end autour de la thématique « Frontières » ; c’est l’occasion de rappeler que je n’y ai encore jamais mis les pieds. Merci de votre attention.
Le cinéma est mort, la preuve : il bouge encore (Guillaume) /
- Parlons cinéma, parlons de ce qui mérite ou pas d’occuper votre temps de cerveau disponibles sur les petits et grands écrans du moment.
- Dans The Alto Knights, Robert de Niro joue le double rôle de Frank Costello et Vito Genovese, deux parrains de la mafia amis, rivaux puis ennemis sur près d’un demi-siècle de vie criminelle dans la Grosse Pomme. À priori, la promesse d’une épopée mafieuse et romanesque scénarisée par l’auteur des Affranchis et mise en boite par le réal de Rain Man constitue un motif de grand-écran qui s’impose. Las, le résultat équivaut tout juste à un dimanche après-midi somnolent devant une plate-forme.
- Tout fringuant octogénaire qu’il soit, De Niro ne peut pas faire grand-chose pour sauver une catastrophe industrielle que personne n’a visiblement réussi à sauver en salle de montage. Sa présence dans les salles obscures a de quoi faire lever plus d’un sourcil. Surtout quand on considère l’empressement de la Warner, productrice de la chose, à bazarder sur sa plate-forme HBO MAX tout ce qui s’éloigne de la ligne éditoriale définie par l’infamant David Zaslav (voir le sort réservé à Juré N°2, le dernier et excellent Clint Eastwood en novembre dernier).

- Ici, les mêmes rôles sont tenus par les mêmes acteurs qui jouaient déjà les mafieux chez Martin Scorsese et David Chase il y a 30 ans, les dialogues (pas aidés par une VF atroce, il est vrai) sonnent comme des chutes de parodies du SNL, et près de la moitié du film est racontée à l’aide de…. diapositifs (si si). De toutes évidences pour remplacer les pages d’une version antérieure du scénario pas tournées ou pas montrables pour des raisons X et Y. Tellement de points de sutures qu’on ne distingue plus rien sous la grosse rature. Sinon une romantisation du bon mafieux contre le mauvais mafieux comme on n’osait déjà plus en faire dans les années 90… Bref, un film de vieux qui n’ont jamais été jeunes. À éviter.
- Avec La fabrique du mensonge, le réalisateur Joachim Lang nous plonge lui aussi dans les images d’archives. Celles des Heures Sombres de l’histoire, générée en grande partie par la propagande de Goebbels, chargé de com -comme on dirait aujourd’hui- du IIIème Reich et véritable chef d’orchestre des « vérités alternatives » érigées en évidences audiovisuelles bues par le peuple jusqu’à la lie. Un sujet en or qui peut vite se transformer en semelles de plomb pour le spectateur craignant de se retrouver devant un cours d’éducation civique mal déguisé en film. Or, pédagogique, La Fabrique du Mensonge l’est assurément, mais au sens cinématographique du terme. Lang a le bon goût de ne jamais nous mettre à distance du spectacle, et fait de nous des complices de la méthode de Goebbels, et sa fabrique de l’entertainment de la bête immonde.
- Contrairement à The Alto Knights, les images d’archives ici sont converties au présent du récit et ne renvoient jamais à un passé extradiégétique. Le spectateur est partie prenante de ce blietzkrieg d’images et sons sur les biais cognitifs du peuple germanique, un peu comme quand Scorsese nous faisait partager la fast-life des criminels en cols blancs dans Le Loup de Wall Street. Si ce n’est qu’ici, le boys club du IIIème Reich dépasse en toxicité tout ce que le capitalisme a pu produire en cannibales socio-économiques. La Fabrique du mensonge raconte aussi cette histoire-là : comme on peut prendre un pays et mettre l’Europe à feu et à sang avec l’effectif d’une start-up perchée et enivrée d’elle-même dans sa tour d’Ivoire, jusqu’à la folie collective. Un grand film sur la société spectacle et les instruments de sa reproduction, donc forcément malaisant : les outils utilisés là-bas à l’époque ne sont pas fondamentalement différent de ceux utilisés ici et maintenant pour occuper ce fameux temps de cerveau disponible. Au fond, Goebbels est à l’opium audiovisuel du peuple ce que Michael Mann est aux braquages urbains et aux gangsters qui regardent l’océan de façon mélancolique : un droit d’auteur permanent et jamais collecté. Aussi, indispensable pour comprendre l’endoctrinement par réseau social interposé : les chose n’ont pas changé tant que ça.
- Comme la musique adoucit les moeurs, Netflix a aménagé sa playlist pour aérer les synapses de ses streamers en ces temps troubles. Ça s’appelle Banger, et ça raconte Vincent Cassel dans la peau d’un DJ sur le retour contraint de collaborer avec la DGSE en s’infiltrant dans un réseau de narcotrafiquant. Là si vous vous dites que tout ça a l’air joyeusement con, c’est normal c’est (bien) fait pour. Bon, l’ensemble aligne parfois les symptômes du premier film présentant plus d’idées que de capacité à les exécuter, et un BPM plus rapide que la musique et souvent trop pour la lisibilité de l’intrigue. Mais il faut mettre au crédit de So Me, graphiste d’Ed Banger Records de son état, un univers de cinéma singulier qui tient plutôt bien sur ses guiboles. Notamment via une direction artistique soignée, et une galerie de personnages secondaires hauts en couleurs mais jamais en roue libre. Perché oui mais dirigé surtout ; ce qui vaut déjà à ce mix entre Zoolander et Jean-Marie Poiré un classement dans la moyenne haute des comédies françaises. À noter également une belle brochette de scènes bercées trop près du mur comme on les aime, et un Vincent Cassel aussi juste qu’attachant dans le rôle principal. Inhabituel et bienvenue pour l’un des ogres proverbiaux du cinéma français. On like et on « recommande ce titre à des amis ».

- On termine ce tour d’horizon des salles plus ou moins obscures avec un feel good/high concept movie qui fait du bien à son petit coeur. Novocaine, c’est le titre mais aussi le surnom de Nate, un conseiller bancaire atteint d’une maladie rare: il ne ressent pas la douleur. Mais VRAIMENT pas, genre même pas la petite démangeaison qui attaque la vessie après (ou pendant, selon les capacités d’accueil) la fin de l‘happy hour. Le monsieur vit donc reclus et surtout le plus loin possible de tous les accidents de la vie que son corps ne pourra pas lui notifier… Jusqu’au rapprochement avec Sherry, une jolie collègue de boulot pour laquelle il soulèvera vents et marées lorsqu’elle se fera prendre un otage suite à un braquage qui tourne mal…
- Novocaine n’est pas l’ersatz aussi tardif qu’opportuniste de Kick-Ass, auquel son pitch peut faire penser. Le film traite d’abord la condition de son héros comme un handicap, aussi bien physique que social. Le scénario de Lars Jacobson bâtit son arène autour de cette idée, et au travers de plein de petits détails intelligemment disséminés qui deviendront cruciaux quand Bambi sortira de sa coquille à la rescousse de l’être aimée. Or, c’est là que Novocaine parvient à dépasser son excellente idée de départ. Car si le héros ne ressent rien, le spectateur si. Toutes les punitions que Nate va s’infliger pour venir à bout de méchants plus entrainés que lui, le public va les vivre par procuration, À SA PLACE.
- Autrement dit, Novocaine est un film qui fait mal, avec un personnage qui ne sait pas ce que ça veut dire. Une heureuse dichotomie qui permet au duo Dan Berk et Robert Olsen derrière la caméra renoue avec un art du slapstick hérité de Sam Raimi, où le public prend tarif pour tout ce que traverse le héros, figure de cartoon se désagrégeant au rythme des épreuves. L’antithèse absolue des John Wick, la franchise qui a ignifugé un cinéma d’action devenu aussi inoffensif à l’impact qu’un coup de taie d’oreiller. Novocaine et son économie de série B très bien gérée, renoue avec le sens du contact le vrai, celui qui transforme un concept malin en odyssée émotionnelle réellement implicante. On saluera la contribution à l’effort de guerre d’un casting judicieusement éloigné des morphotypes industriels des productions équivalentes : l’excellente Amber Mindhunter, et les très belles prestations des « fils de » Ray Nicholson et Jack Quaid, formidable en souffre-douleur résilient pour l’amour de l’art. Allez-y, ça pique et c’est feel-good bref : que du bon.
Ce qui reste de la boxe anglaise (Antoine) /
- Rien n’est plus cruel que l’espoir, surtout quand on espère autre chose qu’une dérouillée, et la divine surprise Bruno Surace de décembre dernier a réveillé les neurones cocardiers des fans français. Las, hier soir à Astana, Anauel Ngamissengue a bien joué le rôle attendu par ses hôtes : faire preuve d’assez de courage pour que brille un Janibek Alimkhanuly de retour devant le public kazakh avant de nous offrir de belles images de KO. Ladite conclusion vint de deux méchantes gauches en contre au 5e round alors que le Français tentait d’inverser une tendance bien peu favorable depuis son voyage sur les fesses en fin de reprise initiale. On aurait pu croire Janibek disposé à garder Anauel au bout de son jab, tant imposer une guerre de tranchées semblait être la seule chance du challenger, mains le champion unifié IBF-WBO des moyens était assez confiant en ses moyens pour accepter le défi. Plus d’allonge, plus de technique, plus de puissance, plus de précision, la liste des avantages du gaucher Alumkhanuly était décidément trop longue pour que Ngammissengue puisse viser mieux qu’une fin digne. Sa place semble plutôt au meilleur niveau européen, auquel on espère le voir accéder rapidement. Quant à Janibek, il est temps pour lui d’embrayer sur un superfight digne de son talent… et si la division sinistrée des moyens peinerait sans doute à le lui offrir, le bougre a largement le gabarit pour survivre à 168 livres.
- Il en est de Joe Joyce comme du pilier de bistrot qu’on apprécie suffisamment pour souffrir de le voir se faire du mal Picon bière après Picon bière, au point de le prier de débarrasser le zinc une bonne fois pour toutes. À 39 ans, « The Juggernaut » offre à ses adversaires une version encore ralentie de lui-même, et sa porosité défensive offrit à Filip Hrgovic, pourtant pas réputé pour son aisance en appui arrière, des boulevards pour sa droite d’école. Si Joyce s’efforça de faire le combat, avançant sans cesse sur le Croate de son train de promeneur asthmatique, et s’il se montra constant dans le travail au corps, il perdit dans les grandes largeurs en termes de précision. Son drame est finalement qu’il lui reste un menton en dépit des efforts déployés par Zhilei Zhang, et qu’il put ainsi manger des bras arrière 10 rounds de plus. Après ce 4e revers en 5 combats, on lui souhaite désormais de se rappeler comment faire ses lacets à 45 ans, ce qui passera vraisemblablement par une nouvelle orientation professionnelle. Hrgovic, lui, pourra encore nous offrir de quoi divertir contre des pensionnaires du top 10, quand bien même il semble manquer d’un poil de punch et de sûreté technique pour espérer grapiller une ceinture.

- De tous les bébés Mayweather qui voulurent ressembler à Floyd en singeant ses attitudes sur et en dehors du ring plutôt qu’en s’inspirant de son CV et de son éthique de travail, Tevin Farmer fut l’un des plus agaçants, au point de me voir longtemps espérer le voir se faire casser la figure. J’avoue avoir jubilé en janvier 2020 quand l’inattendu Jojo Diaz lui ravit son titre IBF des super plume. Revenu sur le circuit en poids léger trois ans et demi plus tard, Farmer a rappelé qu’à défaut de pouvoir reprendre une ceinture il était bien un natif de Philadelphie, soit un type dur au mal doté de fondamentaux solides au-delà des postures. Le gaucher donna d’abord toutes les peines du monde au talentueux prospect Raymond Muratalla, qui dut s’employer en fin de combat pour s’assurer une décision en juillet 2024, avant d’être opposé à la nouvelle terreur des moins de 135 livres William Zepeda. Le Mexicain découvrit alors combien un timing judicieux pouvait contrarier son débit de pistolet mitrailleur ; il visita le tapis sur un contre au 4e round et n’arracha qu’une décision partagée. Une revanche était inévitable, et eut lieu le 29 mars dernier à Cancun. Farmer géra en briscard le démarrage de dragster de Zepeda, et malgré une apparente blessure à la main gauche il mit en place une réplique pertinente tactiquement à mesure que son adversaire se fatiguait. On aurait même pu lui attribuer un knockdown au 12e round, finalement qualifié en glissade avant que les juges ne lui préfèrent Zepeda à la majorité. Les trois défaites de rang de Tevin Farmer ne lui offriront certes pas un avenir immédiat de challenger mondial à 34 ans, mais il peut se targuer d’avoir exposé les failles défensives du Mexicain, voire un certain manque de punch, après avoir fait suer sang et eau Raymond Muratalla. Quoi qu’il arrive désormais à Tevin Farmer, ces derniers mois passés en gatekeeper de luxe lui valent selon moi une respectabilité supérieure à celle qu’il acquit comme champion du monde. Le garçon a d’ailleurs révélé souffrir depuis toujours du syndrome de Tourette, à l’origine de mouvements parasites forcément handicapants sur le ring. Un hommage à Tevin Farmer sur 130livres.com, voilà qui n’était pas gagné sur le papier.
- Tel Jean d’Ormesson disparaissant le même jour que Johnny Halliday, Livingstone Bramble passa sous les radars le 21 mars dernier en tirant sa révérence alors que la planète boxe se rependait en hommages à George Foreman. Défait 26 fois en 69 combats professionnels, le natif de Saint-Kitts et Nevis n’eut certes pas une carrière de pensionnaire du Hall of Fame, mais on doit à ce personnage exubérant, rastafarien fumeur de joints et végétarien revendiqué souvent accompagné en conférence de presse par un serpent domestique baptisé « Dog », l’une des plus grandes surprises des années 80 : un succès par KO au 14 round sur le champion WBA des légers et idole des foyers américains Ray « Boom-Boom » Mancini. Le challenger avait parfaitement calculé son coup, acceptant l’habituel combat de près proposé par son adversaire pour mieux le contrer, tout en s’abritant derrière la garde hermétique permise par des bras très longs pour sa catégorie. Bramble confirma sa victoire initiale en 1984 en remportant une – sanglante – décision unanime (le premier combat de l’Histoire décompté par CompuBox) avant de céder son titre l’année suivante, mis KO à la 2e reprise par le terrible puncheur portoricain Edwin Rosario sans avoir pu faire sauter la banque dans un superfight contre Aaron Pryor ou Hector Camacho. Admiré pour sa condition physique irréprochable, Bramble fit durer jusqu’en 2003 sa vie de boxeur professionnel, accumulant sur le tard plus de revers que de moments de gloire ; il aurait cependant dû battre l’invaincu Oba Carr en 1991 et tint la distance deux ans après contre un jeune Kostya Tszyu. Son coach Lou Duva qualifiait Bramble de cinglé qui faisait tout à l’envers sur un ring, mais qui avait raison de le faire. Ces mecs-là sont le sel de ce sport.
Le MMA va bien, merci pour lui (Guillaume) /
- Parlons MMA, parlons de Benoit Saint-Denis, qui effectuera son retour contre l’Espagnol Joel Alvarez à l’UFC 315 à Montréal. Inutile de préciser que BSD joue gros après deux défaites contre Dustin Poirier et surtout Reinato Moicano, qui lui ont pris autant en termes de capital santé que de hype. Terreur de la division il y a encore un an, le Français que tout le monde voyait défier Islam Makhachev avant la fin 2024 doit maintenant refaire ses preuves au sein de la division la plus difficile de l’UFC. Qui plus est contre un client : Alvarez n’a pas (encore ?) l’envergure ou l’aura d’un contender à la ceinture, mais il reste sur une série de trois victoires d’affilée, et sa morphologie atypique pour la caté (1, 91m pour les 70 kilos !) en fait automatiquement une corvée pour tous ceux qui croisent le fer avec lui dans la cage. Reste que BSD a plus d’un tour dans son sac, et notamment la présence dans son coin de Nicolas Ott, head-coach d’élite qui a su emmener Nassourdine Imavov au sommet des -84 kgs. Gageons qu’avec un tacticien de ce calibre, Saint-Denis dispose de toutes les cartes en mains pour se transformer, et revenir une nouvelle fois au sommet d’une catégorie qui commence à manque de challenge pour le taulier. On murmure en effet que Makhachev zieuterait le passage à la catégorie au-dessus avec de plus en plus d’insistance, après avoir quasiment nettoyé la division. Une remontada s’impose.

À noter que sur la même carte et en main event, Manon Fiorot tentera de ravir à la reine Valentina Shevchenko la couronne des -57 kgs. On vous en fera une preview le moment venu.